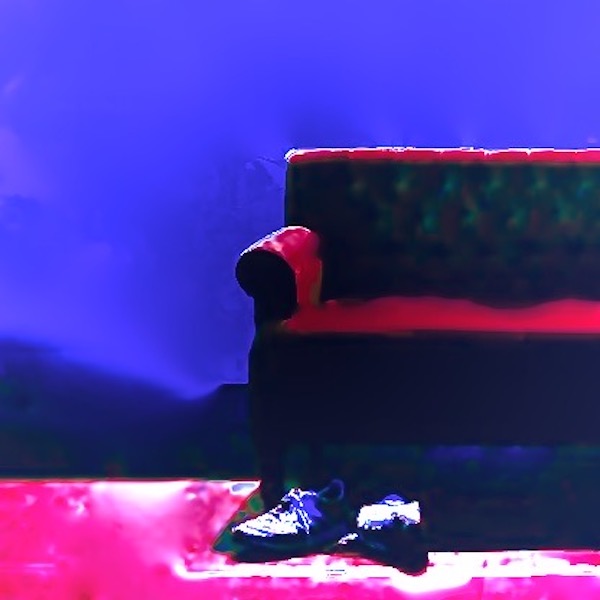
La nuit, quand revient la nuit, il y a ceux qui dorment et les autres, les insomniaques en errance, les somnambules à l’écoute des fantômes. Entre deux fuseaux horaires, branchés sur les programmes de nuit de la télévision ils se rencontrent et tentent ensemble d’échapper aux cauchemars du sommeil.
Quand revient la nuit il y a ceux, aussi, qui vont au théâtre voir Les Absent.e.s dont les trois premières représentations ont eu lieu au théâtre El Duende en cette fin d’octobre 2021. La pièce, signée de l’autrice Ellen Huynh Thien Duc, est une mise en scène collective des BdThé, une compagnie fondée en 2016 par six comédiens et comédiennes prônant une organisation démocratique de la compagnie et du plateau.
La première scène présente Julian. Son corps est là, sur scène, comme un résidu. Sa voix est ailleurs, dans un enregistrement, on l’entend dédoubler, d’abord sa voix d’homme qui se remémore un souvenir, et puis, superposée, sa voix d’enfant, qui le raconte comme au présent. Déjà la pièce joue dans deux temporalités, brise la frontière du temps, du lointain, de la prescription. Déjà elle nous prévient : oui Julian est un adulte, mais durant tout le spectacle c’est l’enfant qu’il nous faudra entendre derrière sa voix comme un double fond, une voix cachée qu’on voudrait faire taire. Ne pas entendre. Le spectacle commence à peine, on sait déjà qu’on va aller « loin, très, très, loin ».
L’ambiance est installée, nappe sonore flottante, teinte bleutée, mais tout de suite une rupture de ton, d’ambiance, de théâtre. Et chaque fois que l’on croira pendant cette heure vingt comprendre les modes de jeu, chaque fois que le spectateur sera tenté de se satisfaire de ce qu’il voit, alors la pièce ira chercher ailleurs. Ici donc Louis, le frère de Julian, nous fait face avec Elena sa fiancée. La scène est leur salon, scène conjugale relativement classique donc et pourtant quelque chose ne va pas... ils ne se regardent pas et parlent côte à côte. Il sont ensemble et en fait pas : Louis est à l’hôpital, il prévient son frère que sa mère est morte la nuit dernière. Il est là et absent à la fois. Elena, elle nous parle en adresse directe, c’est la seule qui le fera, parce qu’elle est l’hôte, notre porte d’entrée, peut être la seule par laquelle tout tient encore. Ce couple est à un mètre de distance l’un de l’autre et pourtant il y a comme une dissonance. Une rupture de communication, ça ne se parle pas. On ne communique pas ensemble, on utilise des intermédiaires, des subterfuges.
La pièce est peuplée de fantômes, comme des cris lointains qui sont aussi des grincements de porte étouffée. Comme des feux follets auditifs. D’autres cris aussi à quelque moment, vus, mais pas entendus, la bouche grande ouverte, la voix étouffée.
Le décor unique présente le salon de la maison familiale, celle que Julian a fuit plus jeune après avoir poussé sa mère dans les escaliers, celle dans laquelle Louis vit encore avec Elena, dans laquelle ils se sont occupés de la mère devenue handicapée. Les murs de la pièce sont décrépis, la tapisserie tombe en lambeau, les murs pourrissent en profondeur. C’est un foyer au bord de l’effondrement et pourtant les personnages eux ne voient pas ce que nous nous voyons. « Vous avez changé le papier peint. » Tout prend l’eau pourtant « c’est étrange comme les oiseaux continus à chanter ». On raconte que même dans les camps de concentration, indifférents à l’horreur, les oiseaux chantaient, là, indifférente au drame, la famille a continué de vivre.
En choisissant de retourner dans la maison de sa jeunesse pour y confronter les fantômes de son passé, Julian empreinte le même chemin que d’illustres prédécesseurs – de Louis dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Largace à Hiroshi le héros de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Les Absent.e.s ne pâlit pas de la comparaison et ose le subtil mélange de scènes de confrontation familiale brute et de scènes de confrontation onirique qui explorent et exposent les non-dits. Cette thérapie du retour en arrière questionne le rapport à l’héritage : « Entre ! C’était ta maison, ça l’est toujours. » Que faire d’un héritage qu’on refuse, mais qui peut être et malgré tout nous constitue ? Peut- on reconstruire malgré des bases pourries ou vaut-il mieux tout détruire et repartir sur des fondations saines ? Ces questions la pièce ne les pose jamais, car elle trop occupée à les mettre en jeu, à en faire théâtre. Jamais elle ne se perd en discours abstrait, tout n’est que situation. Concrète, petite, précise. Dans Contre le Théâtre Politique Olivier Neuveu parle de l’importance du petit pour saisir le concret de la situation : « S’attacher au «Petit» [...] tente de cerner la tension qui se noue entre la nécessité du détail et l’immensité de ce qu’il y a à embrasser, entre le fini et l’infini, l’accessoire et le gigantesque, le prosaïque et la démesure. Le «Petit», c’est la contrainte du castelet, fût-il agrandi aux mesures d’un stade, déployé en pleine rue, ou rapporté aux dimensions d’un corps.»1 Et de citer Sony Labou Tansi : « Je travaille sur le théâtre parce qu'il est la meilleure possibilité de mettre les choses à la dimension du corps, du sang, de la sueur, de l’aura, du muscle qui dit sa part du monde à voix basse ou bien à haute voix. L'acteur est la seule occasion qui nous reste de donner la chair de poule aux choses et à l’idée.»2
Et c’est à cet endroit que la pièce devient théâtralement intéressante. Parce qu’elle ne se contente pas d’exposer son propos ou de le faire vivre aux personnages qu’elle met en scène. Elle met le spectateur dans la position de celui qui écoute, mais n’entend pas. Comme les personnages de la pièce le spectateur ne saisit pas ce qui joue, alors même que chaque mot écrit supplie, crie sans bruit, aux détours d’une chanson, d’une discussion, des appels à l’aide. On cherche à comprendre, on est mis dans cet état du bout de la langue, du presque là et quand ça semble venir, il se passe quelque chose, le spectacle nous attire ailleurs, nous empêche de formuler. Ça retient. Et c’est cette retenue qui fait sa force, sa pudeur et sa grâce. « Sort moi d’ici. Frère. S’il te plait. » tous les mots hurlent le drame, tous ; mais les BdThé ont choisi leur robe bleue pailletée plutôt que leur tenue d’enterrement. Il ont choisi que ça passe par en dessous, sans en avoir l’air. Ils sont
en adresse directe avec notre intimité, comme deux écoutes en simultané du spectacle, l'une en surface fera parfois rire, parfois penser, l’autre en dessous sans y paraître transperce le cœur comme une lame profondément ancrée. Quand vient enfin le moment de la prise de conscience paroxystique, nous ne sommes pas surpris puisqu’au fond de nous, nous savions. Là l’écriture est redoutable : tout se joue entre les mots, dans les interstices du sens, ça transforme le sujet en expérience.
Pour mettre en place ce processus subtil, la pièce doit passer par le rêve, par donc une déformation du réel, une mise en scène. Pour que soit formulée la vérité, la pièce doit faire théâtre, c’est-à-dire qu’elle prend sur elle de faire voir, de donner à voir une certaine justesse, mais comme à travers un miroir grossissant, déformant. L’opération théâtrale, semblable à celle du rêve dans la pièce, a cet effet presque herméneutique de la sensation. Elle va amener Julian à enfin dire. Et nous allons être amenés à l’entendre enfin. Pour Marie José Mondzin : « la vérité exige le voile et que celui qui ne s’en remet qu’au visible saisi par ses yeux pour déterminer la vérité, porte atteinte à la nature imaginaire du vrai. Il n’existe pas de vérité toute nue.»3 C’est certainement pour cela que tout se joue la nuit, à l’heure des ombres, du voile d’obscurité. Julian est en lutte contre de tenaces fantômes « Maintenant que maman est morte, elle ne nous quittera plus jamais ». C’est l’insidiosité des morts. Pour vaincre, pour s’avouer, pour se libérer, pour vivre, Julian va devoir plonger dans le subconscient, revenir en enfance. Une fois encore chez les BdThé tout passe par le jeu, le travail physique de l’acteur. Ça se passe dans ses yeux (ceux de son père), dans les traits de son visage qui s'affaisse, dans les jeux d’ombre et de lumière.
Pour finir il nous faut évoquer rapidement la compagnie des buveurs et buveuses de Thé et ce processus de création, si particulier en lui-même qui suffit à leur créer une identité. Précisons que trop rares sont ceux qui appliquent hors scène les idées ou théories plus ou moins moralisatrices qu’ils assènent sur scène à un public souvent acquis. Et si cette pièce est une sensation – jamais un message, jamais une affirmation – c’est celle du besoin, peut être de l’importance, de l’écoute, de l’attention, de la communication. Certainement ces qualités sont essentielles au bon déroulement d’une création collective et certainement c’est parce que les BdThé les ont éprouvées qu’ils arrivent à en transmettre l’essence avec une intelligence et une finesse toujours au service du poétique. Pas étonnant alors que la figure d’un metteur en scène jaillissant de-ci de-là dans le spectacle nous apparaisse si toxique dans son désir obsessionnel à ce que l’acteur soit désirable. Eux savent que l’important est ailleurs.
Il faudra que des gens de théâtre programment Les Absent.e.s, c’est une nécessité non pas parce que le spectacle est particulièrement malin (il l’est), mais parce qu’on n’imagine pas qu’une jeune compagnie si ambitieuse dans ses propositions hors et sur scène ne trouve pas de nouveau et pour longtemps la voie du plateau.
