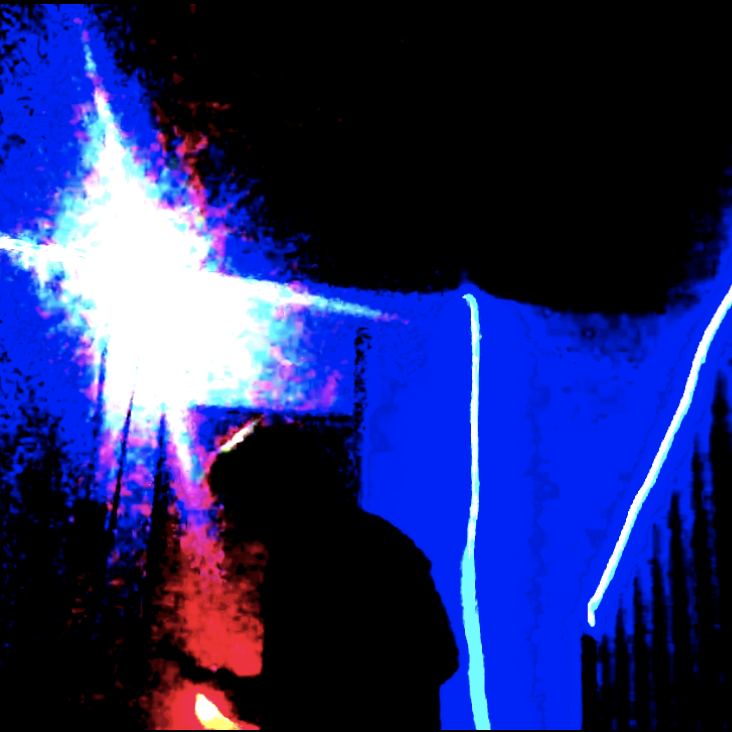Cette expérimentation s’est déroulée dans le cadre d’un atelier de pratique en espace public dirigé par Alix Denambride et Christophe Modica. Elle n’est que le fragment d’une proposition plus grande conçue à l’initiative d’un groupe de 5 étudiant.e.s dont j’ai fait partie.
En 1940, L’Invention de Morel de l’écrivain argentin Adolfo Bioy Casares met l’Homme face aux problématiques de l’image et du son. Ici l’Homme est criminel par nature, il fuit ses démons et trouve mirage dans l’image qui le détourne de ses troubles. Elle le fascine jusqu’à l’amour. Et le son comme funeste annonce, le cri des sirènes, qui pousse à tourner la tête, à regarder, à plonger. Une fois sous l’eau ils nous est presque impossible de respirer une bouffée d’air frais, hypnotisé, on en veut toujours plus…
Aujourd’hui, 2020 et son flux d’image continu confirme les craintes. Le trop plein aseptise notre perception du monde. Ici un enfant mort sur une plage, là une marrée de manifestant tabassés par les forces de l’ordre, dans les rues crevant d’alcool ceux que Patrick Declerck à nommé Les naufragés. Noyés nous ne voyons plus. Et le son comme funeste annonce, le cri des sirènes, qui pousse à tourner la tête, à regarder la télévision, la publicité, le monde qui s’effondre mais comme au loin derrière une fenêtre. « La vérité exige le voile. Celui qui ne s’en remet qu’au visible saisi par ses yeux pour déterminer la vérité, porte atteinte à la nature imaginale du vrai. Il n’existe pas de vérité toute nue. » Écrit Marie-José Mondzain. Ce trop plein pornographique, cette fascination morbide à profondément changé notre perception du monde.
Et si, au détour d’une proposition de Christophe Modica et Alix Denambride, il nous fallait réfléchir sur cette invention de Morel, que pourrions nous proposer à quelques spectateurs ? Quel dispositif, quelle Séquence ? En lutte contre l’image crue nous pourrions penser retourner contre elle son arme sonore. Il ne s’agirait alors pas d’illustrer mais de faire vivre, d’abord par le son, la sensation d’un flux au sens latin du termes, fluxus, l’écoulement. La nostalgie d’une nocturne de Chopin qui viendrait comme accrocher l’oreille. La simplicité de ses quelques notes au piano qui serait tout à la fois large Synthé, aériennes clochettes et inquiétants chants d’enfant comme en opposition à l’autre flux, celui du monde extérieur. Ici rien de nouveau, rien d’exaltant, l’eau monte. « Apres moi, le déluge »
Et puis un hommes nu trempé et un enfants sous l’escalier qui ne sont pas des images mais des présences. Ils attendent, tentent peut être une conversation qui reste peu compréhensible. Pour eux, l’homme et l’enfant, quelque soient leurs histoires, c’est un purgatoire. Pour les autres, spectateurs, une purge. Ensemble, serrés dans une poignée de mètre carrés, ils contemplent l’inutilité duchampienne d’un escalier qui ne mène a rien, d’un écran d’ordinateur qui n’affiche qu’un logiciel de son, de quelques lumières abstraite.
Imaginons qu’alors, pour combler le vide, l’imaginaire de chacun se déploierait, remplissant tout l’espace. Nous tenterions ainsi de réaliser la prédiction de Casares qui écrit que seul une inondation pourrait à jamais ensevelir l’invention, enrayer la machine. Tout ce que nous pourrions souhaiter c’est que ces quatre minutes de temps long auront fait miroiter un autre flux possible, un autre rapport à l’image du monde.